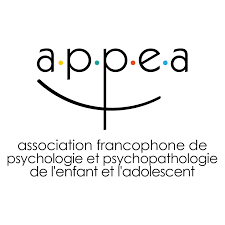Amèle El Achhab
Adaptation et validation du Childhood Autism Spectrum Test (CAST) en langue Arabe
Université Mohamed VI et Chaalet-Jonas, Casablanca, Maroc
Du dépistage au diagnostic du TSA
Dépister et diagnostiquer relève de deux démarches différentes : dans la première, le dépistage, le TSA est décrit comme l’extrémité d’une dimension appelée « trait autistique », dans la seconde le TSA répond à une suite de critères. Dans la première le TSA est « repéré » à l’aide de questionnaires administrés aux parents, dont les réponses obtenues sont binaires
(oui/non). Dans la seconde, il d’agira de vérifier la positivité de critères pour poser le diagnostic. C’est ainsi que fonctionnent les deux classifications internationales qui font référence à ce jour, le DSM-5 (American Psychiatric Association, 2015) et la CIM-11 (World Health Organization, 2011).
Le DSM-5 mobilise 5 critères : deux critères cliniques, c’est-à-dire définis par l’observation du comportement de la personne (critère A et B) (A. Déficits persistants de la communication et des interactions sociales et B. Caractère restreints et répétitifs des comportements, des intérêts ou des activités), un critère qui nécessitent un repérage précoce de ces comportements dans les premiers développements (critère C), un critère selon lequel, ces comportements ont un impact négatif (notion de désavantage) sur le développement (critère D), et enfin un seul critère qui permet d’éliminer un autre phénomène qui pourrait présenter les mêmes caractéristiques cliniques (critères A et B), à savoir une déficience intellectuelle.
En psychopathologie, l’ensemble de cinq critères représente un trouble, les critères A et B sont des symptômes, et l’association des critères A et B un syndrome.
La probabilité pour que ces cinq critères soient présents simultanément chez un même sujet renvoie à la prévalence du trouble. On estime aujourd’hui qu’elle est un peu supérieure à 1 % (Fombonne, 2018).
Dans la dépistage, le questionnaire est seulement conçu pour repérer la symptomatologie du trouble, en l’occurrence ce qui est décrit sous la forme des deux premiers critères A et B des classifications.
Il importera donc de bien différencier ces deux démarches qui, par définition, n’aboutissent pas à capturer la même prévalence du phénomène.
Le CAST
Le Childhood Autism Spectrum Test (CAST), aussi connu sous le nom de Childhood Asperger Syndrome Test, est un outil conçu pour la détection précoce des troubles du spectre autistique (TSA) chez les enfants âgés de 4 à 11 ans. Il se présente sous la forme d’un questionnaire rempli par les parents, centré sur les comportements qui sont généralement présents dans un TSA tels certains comportements sociaux et des intérêts restreints. Il vise donc à identifier les enfants qui pourraient bénéficier d’une évaluation plus détaillée de TSA dans le cadre d’une démarche diagnostique.
Développé par une équipe d’experts dans le domaine de la recherche sur l’autisme, le CAST consiste en une série de questions auxquelles les parents ou les principaux dispensateurs de soins répondent en fonction de leurs observations du comportement et des interactions de l’enfant. Le questionnaire est conçu pour être à la fois complet et accessible, ce qui permet de l’utiliser dans divers contextes, notamment les soins primaires, les environnements éducatifs et le foyer familial. L’accent mis sur les observations rapportées par les parents tire parti des connaissances détaillées que les soignants ont souvent sur le comportement de leur enfant dans divers contextes et situations sociales.
Le CAST met l’accent sur la petite enfance, une période cruciale pour le développement des compétences sociales et communicatives. En fournissant un cadre structuré pour évaluer les comportements associés aux TSA, le CAST peut jouer un rôle essentiel dans le processus de diagnostic, guidant ainsi les familles et les professionnels vers une évaluation plus approfondie si nécessaire.
Le questionnaire a été traduit dans une quinzaine de langues. Ces traductions ont été validées dans le seul cas du mandarin (Sun et al., 2014 du bulgare (Vulchanova et al., 2016 et de l’espagnol (Morales-Hidalgo, Roige-Castellvi, Vigil-Colet & Canals Sans, 2017. Une traduction française existe (Weiner Luisa, 2007, mais elle n’a pas été validée. Bien qu’une version arabe existe (Mohanad N.Sabry) celle-ci n’a pas été validée (Annexe A). Or ces pays ont des pratiques sociales différentes de celles des pays occidentaux. Par exemple, concernant l’absence de contact visuel, dans la culture arabe, sa présence chez un enfant envers un adulte est signe d’irrespect (Vanegas, Magafia, Morales & McNamara, 2016.
Maroc et Langue arabe
L’arabe est la langue officielle de 25 pays, ces 25 pays comptabilisent une population totale de 538 millions d’habitants (Organisation des Nations unies, 2015). C’est le quatrième espace linguistique au monde. Mais au sein de cet espace, un morcellement linguistique est présent, donnant naissance à plusieurs dialectes parlés au niveau local. Ainsi, même si la langue écrite reste la même (arabe classique), elle reste relativement peu utilisée notamment dans les pays de l’Afrique du Nord comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, etc. Ainsi, dans le cas du Maroc, bien que la langue officielle soit l’arabe classique, elle est utilisée seulement par les administrations. Sur les 36 millions de Marocains, 60 % de la population parle un autre type d’arabe, l’arabe dialectal ou darija (Lecler, 2018. La darija est la langue maternelle de tous les Marocains natifs. Lorsqu’on s’intéresse aux gens analphabètes (32 % de la population marocaine, en forte diminution comparée au 87 % de 1960), cette large partie de la société marocaine ne connaît pas l’arabe classique (Haut-Commissariat au Plan, 2018). La darija reste un dialecte trèsinstable pouvant varier d’une région à l’autre, trèssensible à des phénomènes de contamination d’autres langues. Ainsi, au nord du Maroc, dans la région de Tanger Tétouan, beaucoup de mots d’origine espagnole sont inclus dans leur darija alors qu’à Casablanca de nombreux mots sont empruntés de la langue française. La traduction en darija présente donc un défi important : il est nécessaire d’employer des mots connus et compris par toutes les régions du Maroc et d’avoir une darija consensuelle ou langue-toit. Le Maroc constitue une véritable passerelle entre l’Afrique et l’Europe, il regroupe une population très contrastée d’origines diverses (arabe, su africaine, berbères et européenne). Le pays est à grande majorité de confession musulmane même si plusieurs religions cohabitent (musulmane : 99 %, chrétienne : < 1 %, juive : < 0,1 % ; Central Intelligence Agency (2009) Par ailleurs, le Maroc fait partie des pays en voie de développement où subsistent d’importantes. disparités dans le niveau d’éducation. Ainsi, l’ensemble de ces caractéristiques font du Maroc un pays ou les facteurs risquant de biaiser l’examen psychologique en utilisant des tests non adaptés se cumulent.
Traduction et adaptation du CAST
Les critères suivants ont été adoptés (Hambleton, Merenda et Spielberger, 2005; Sousa & Rojjanasrirat, 2011):
1. Utilisez des phrases courtes et simples, et évitez les mots inutiles.
2. Employer la voix active plutôt que la voix passive parce que cette dernière est plus facile à comprendre, et difficile à traduire dans certaines langues
3. Répétez les noms au lieu d’utiliser des pronoms parce que ces derniers peuvent avoir de vagues références ; par exemple, le « vous » anglais peut se référer à une seule personne ou à un groupe de personnes.
4. Évitez les métaphores et les expressions familières. Dans de nombreux cas, leurs traductions ne seront pas adéquates.
5. Évitez les verbes et les prépositions qui n’ont pas de signification précise, comme « bientôt » et « souvent »
6. Éviter les formes possessives dans la mesure du possible, car il peut être difficile de déterminer la propriété. La propriété telle que « son » dans « son chien » doit être dérivée du contexte de la phrase, or les langues varient dans leur système de référence
7. Utiliser des termes spécifiques plutôt que des termes généraux.
8. Les développeurs / éditeurs d’instruments doivent fournir des preuves que leurs choix de tests techniques, les conventions de test et les procédures sont familières à toutes les populations, et centrées culturellement
9. Les concepteurs / éditeurs d’instruments devraient fournir la preuve que le contenu et les matériaux stimulus sont communs à toutes les populations, autrement dit universels.
La version arabe du Childhood Autism Spectrum Test (Scott et al., 2002) était conçue en utilisant la méthode de traduction renversée (retro-traduction) (Hambleton et al., 2005). Dans un premier temps, une traduction de l’anglais (voir Annexe B) vers l’arabe a été réalisée par deux cabinets de traductions assermentées (voir Annexe C). Cette traduction n’était pas mot à mot, une adaptation à la culture arabe a été nécessaire. Ainsi, parmi les 31 items du questionnaire CAST original, les traducteurs ont été informés de l’importance d’exposer de façon précise les différents aspects du questionnaire original, dans un arabe simple et compréhensible de toutes les différentes cultures arabes pour la version arabe et une darija compréhensible de toutes les régions du Maroc pour la version marocaine. Puis, les deux traductions ont été retraduites dans le sens inverse, de l’arabe vers l’anglais (voir Annexe D). Finalement, les versions originales et traduites du questionnaire étaient comparées par un comité d’experts. Ce comité était composé de 4 personnes bilingues appartenant au monde universitaire et clinique. La version traduite ayant le plus d’avis favorables a été sélectionnée (voir Annexe E). Un test préliminaire a été fait sur une population de 10 personnes. Des sept étapes recommandées par (Sousa & Rojjanasrirat, 2011), seule la sixième n’a pas été réalisée par manque de temps. Bien qu’il n’y ait aucune analyse réalisée sur la version darija, les documents concernant la version darija sont également en annexe : traduction anglaise vers darija (voir Annexe F), darija vers anglais (voir Annexe G) et version finale (voir Annexe H).
Population
Les données ont été obtenues à partir d’une cohorte de 2140 enfants (976 filles), âgés entre 4 et 11 ans (M = 7,41 ans, ET = 2,32) : 1240 enfants (M = 7,55 ans, ET = 2,42) pour la version arabe et 900 enfants (M = 7,23 ans, ET = 2,18) pour la version darija. Les passations se sont déroulées à Casablanca dansles écoles du Groupe SUBRINTI et à l’association SOS Village. Aucun n’avait redoublé de classe. Le consentement des parents a été recueilli sous forme écrite après que ces derniers aient été informés de la nature de l’étude. Le protocole expérimental a été réalisé en accord avec la Déclaration d’Helsinki.
Concernant les enfants avec TSA, les parents ont complété un questionnaire sociodémographique (voir Annexe I) et ont répondu au CAST afin d’identifier les enfants avec des risques de TSA. Tous les enfants qui avaient un score supérieur à la valeur de cut-off du CAST, c’est à dire 15, étaient individuellement évalués. De la même façon, un groupe contrôle a été créé : 5 % des enfants avec un score compris entre 0 et 14 ont été choisis aléatoirement pour également être évalué constituant ainsi deux groupes. Ces deux groupes ont été évalués en utilisant les questionnaires de détection de l’autisme, c’est-à-dire l’ADI-R et l’ADOS-2. Un groupe de cliniciens réalisait les diagnostics en se basant sur les critères du DSM-5. Les cliniciens étaient au nombre de 3 : deux psychologues ayant réalisé les formations pour l’ADI R et l’ADOS-2 et un médecin psychiatre. Lors des évaluations cliniques, les trois cliniciens étaient toujours présents et un enregistrement vidéo était réalisé avec le consentement des parents. Ils n’avaient pas connaissance du groupe auquel appartenait le participant.
Analyses statistiques
La consistance interne des items a été estimée en utilisant le test alpha de Cronbach. Les coefficients de validité ont été calculés en utilisant la corrélation de Pearson. Enfin, une analyse factorielle a été utilisée pour comparer la structure factorielle de l’adaptation arabe du CAST avec les structures rapportées dans les autres traductions. L’analyse d’exploration factorielle a été faite en se basant sur une matrice de corrélations tétrachoriques puisqu’elles sont recommandées pour les items dichotomiques (Flora, LaBrish & Chalmers, 2012). Pour trouver le nombre optimal de facteurs, le scree-test de Cattell (1966) a été utilisé. Toutes les analyses ont été réalisées en utilisant le logiciel R (Core et al., 2013).
Résultats
Statistiques descriptives
Les caractéristiques des participants de l’étude sont résumées dans le Tableau 1. Les autres données sociodémographiques feront le sujet d’analyses ultérieures.
A ce jour, 59 entretiens ont été réalisés. Le Tableau 2 répertorie les différentes étapes pour arrivera ce nombre d’entretiens.
Consistance interne
Le coefficient alpha de Cronbach est 0,84. De même, une analyse de corrélation de chaque item avec le score total montre une bonne consistance des items.
Analyse exploratoire
Une analyse exploratoire factorielle a été menée en incluant tous les 31 items scorés du questionnaire. L’erreur quadratique moyenne (RMSR) était de 0,01. Suite à une analyse des Eigen values et du screen-test, un modèle à deux facteurs s’est montré le plus performant. Le Tableau 3 rapporte la matrice des poids factoriels après rotation des facteurs. Ainsi, au total, 14 questions composent le Facteur 1 et 17 questions composent le Facteur 2. Le Facteur 1 semble correspondre aux interactions sociales et à la communication alors que le Facteur 2 aux comportements restreints.
Indices psychométriques
Toutes les analyses ROC n’ont pu été faites, mais sur les 9 participants ayant un score supérieur à 15 au CAST, 4 ont été diagnostiqués TSA. La valeur prédictive positive est donc pour l’instant de 44 %. Pour les TSA précédemment diagnostiqués (11), tous ont eu un score supérieur à 15 au CAST, d’où une sensibilité de 100 %. La spécificité est de 96 %. Basés sur notre échantillon de 1240 participants, 42 ont eu un score supérieur à la valeur cut-off. Si la valeur prédictive positive reste la même sur l’ensemble des entretiens, la prévalence des TSA serait ainsi de 1,49 %.
Discussion et conclusion
Le test alpha de Cronbach de 0,84 témoigne d’une bonne consistance interne du CAST arabe similaire à celle rapportée dans les autres études, seul Morales- Hidalgo et al. (2017) a donné une valeur alpha (a = 0,826). Ce résultat assure la faisabilité et la fiabilité de cette version.
La traduction arabe a montré de plus de hautes valeurs de sensibilité, de spécificité et une valeur de prédiction positive moyenne, mais proche des résultats obtenus lors de la validation originale et des autres adaptations : pour Scott et al. (2002) 100 %, 97 % et 50 % ; pour Morales-Hidalgo et al. (2017) : 83.9 %, 92.5 %, 63 % respectivement ; aucune information n’a été donnée par Sun et al. (2014), Vulchanova et al. (2016).
L’analyse factorielle a fait ressortir deux facteurs principaux composant la structure interne du questionnaire. Ces deux facteurs sont semblables aux différentes adaptations réalisées dans d’autres langues (Morales-Hidalgo et al., 2017 ; Scott et al., 2002 ; Sun et al., 2014 ; Vulchanova et al., 2016). La seule différence est qu’aucune question n’a été rejetée des deux facteurs. Chaque question est attribuée à un seul facteur, signe d’une bonne décomposition. Si les items étaient présents dans les deux facteurs, cette co-occurrence amènerait un problème d’indépendance entre les deux construits basés sur les deux facteurs. Le facteur 1 correspond au premier critère principal caractérisant le TSA, celui de l’interaction sociale et de la communication. Par exemple, les questions 1 et 10 appartiennent à ce facteur. La question 1 correspond à « Est-ce que l’enfant joue facilement avec les autres enfants ? » et la question 1° est « Est-ce qu’il trouve facile d’interagir avec les autres enfants ? ». Quant au facteur 2, il correspond au deuxième critère principal : les comportements restreints. Les questions 7 et 28 sont de cette famille. La question 7 est « Est-ce qu’il tend à prendre les choix à la lettre ? » et la question correspond à « Est-ce qu’il a des mouvements répétés et inhabituels ? ».
Ces deux facteurs correspondent aux deux critères principaux caractérisant le TSA : interaction sociale et communication et comportements restreints.
Quelques limites peuvent être cependant mentionnées. Tout d’abord, l’utilisation de l’ADI-R et de l’ADOS-2 dans leurs versions françaises peut amener un certain biais. En effet, les outils de diagnostics du TSA sont créés à l’origine dans des pays anglophones puis une traduction est faite. Par exemple, pour l’ADI-R, il a été publié dans 17 langues (Western Psychological Services, 2018), mais leur méthode de traduction et de validation est très hétérogène et aucune version validée en langue arabe n’est disponible. L’ADI-R et l’ADOS-2 ont donc été utilisés en version française avec traduction par les professionnels de santé des termesincompris en darija pour les participants arabophones. Lestermestraduits n’ont donc pas été validés.
Une valeur moyenne de prédiction positive est l’un des défauts de la version originale du CAST (J. Williams et al., 2005), défaut également présent dans notre étude. Cette faible valeur pourrait provenir de la faible prévalence du TSA. Découlant de ce constat, une certaine réflexion déontologique peut être faite : un dépistage positif peut induire une certaine anxiété chez les parents, anxiété qui sera supprimée lorsque le diagnostic viendra contredire le dépistage.
En conclusion, cet outil de dépistage présente de nombreux avantages pour améliorer la prise en charge précoce. Ainsi, un meilleur dépistage du TSA devrait permettre de : (1) mieux quantifier la prévalence du TSA dans les pays arabes. (2) De mieux saisir l’impact multidimensionnel de ces troubles en tenant compte des caractéristiques culturelles et psychosociales d’un pays arabe. (3) De recentrer les prises en charge afin de développer des interventions adaptées et efficaces pour répondre aux nombreux besoins des patients, des familles, de la société civile marocaine en particulier et de manière plus globale de la population arabe. Par ailleurs, il pourrait être intéressant d’en créer une version en ligne afin de le rendre réellement accessible et de démocratiser ce dépistage. Basé sur la revue de van Ballegooijen, Riper, Cuijpers, van Oppen et Smit (2016), il pourrait être intéressant de valider une version en ligne.
Références
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disor-ders(DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Asouab, F., Agoub, M., Kadri, N., Moussaoui, D., Rachidi, S., Tazi, M. et al. (2007). Prévalence des troubles mentaux dans la population générale marocaine (Enquête nationale, 2005) [Prevalence of mental disorders in the Moroccan general population (National Survey, 2005)]. Bulletin Épidémiologique, Direction de l’Épidémiologie et de Lutte Contre les Maladies, ministère de la Santé du Maroc, 61-62.
Baron-Cohen, S., Scott, F. J., Allison, C., Williams, J., Bolton, P., Matthews, F. E. & Brayne, C. (2009). Prevalence of autism-spectrum conditions: UK school-based population study. The British Journal of Psychiatry, 194(6), 500-509.
Cattell, R. B. (1966). The screen test for the number of factors. Multivariate behavioral research, 1(2), 245-276.
Centers for Disease Control and Prevention. (2014). Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network Surveillance Year 2010. MMWR Surveill Summ, 63(2), 1- 21.
Central Intelligence Agency. (2009). The CIA World Factbook 2017 – Morocco. Récupérée 25 juillet 2018, à partir de https ://www.cia. gov/library/publications/the world- factbook/ geos/mo.html
Chaman, T. & Gotham, K. (2013). Measurement Issues: Screening and diagnostic instruments for autism spectrum disorders—lessons from research and practise. Child and adolescent mental health, 18(1), 52-63.
Cidav, Z., Marcus, S. C. & Mandell, D. S. (2012). Implications of childhood autism for parental employment and eamings. Pediatrics, peds-2011.
Collectif autisme Maroc.(2015). Statistiques officielles. Récupérée 25mars 2018, à partir de http://www.collectifautisme.ma/
Core, R. et al. (2013). R: A language and environment for statistical computing. Filipek, P. A., Accardo, P. J., Baranek, G. T, Cook, E. H., Dawson, G., Gordon, B., … Levy, S. E. et al. (1999). The screening and diagnosis of autistic spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 29(6), 439-484.
Flora,D. B., LaBrish, C.&Chalmers, R. P.(2012).Old and new ideasfor data screening and assumption testing for exploratory and confirmatory factor analysis. Frontiers in Psycho logy, 3, 55.
Gernsbacher, M. A., Dawson, M. & Hill Goldsmith, H. (2005). Three reasons not to believe in an autism epidemic. Current directionsin psychologicalscience, 14(2), 55-58.
Gilliam, J. E. (1995). Gilliam autism rating scale: Examiner’s manual. Pro-ed. Hambleton, R. K., Merenda, P. F. & Spielberger, C. D. (2004). Adapting educational and psychological testsfor cross-cultural assessment. Psychology Press.
Hambleton, R. K., Merenda, P. E & Spielberger, C. D. (2005). Issues, designs, and technical guidelines for adapting tests into multiple languages and cultures. In Adapting educational and psychological testsfor cross-cultural assessment(p. 15-50). Psychology Press.
Haut-Commissariat au Plan. (2018). Note d’information du Haut-Commissariat au Plan à l’occasion de la journée internationale de l’alphabétisation du 8 septembre 2017. Récupérée 25 juillet 2018, à partir de https : //www . hcp . ma/ region – drda/ Note – d information ¬du – Haut – Commissariat – au – Plan – a -1- occasion – de – la- journee – internationale – de – 1-alphabetisation- du- 8_a179.html
Hollingshead, A. B. et al. (2011). Four factor index ofsocialstatus.
Kanner, L. et al. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous child, 2(3), 217-250. Le Couteur, A., Haden, G., Hammal, D. & McConachie, H. (2008). Diagnosing autism spectrum disorders in pre-school children using two standardised assessment instruments: the ADI-R and the ADOS. Journal of autism and developmental disorders, 38(2), 362-372.
Lecler, J. (2018). Maroc – Situation démolinguistique. Récupérée 25 juillet 2018, à partir de http://www.axl.cefan.ulaval.ca
Lord, C., Rutter, M. & Le Couteur, A. (1994). Autism Diagnostic Interview-Revised: a revised version of a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developmental disorders. Journal of autism and developmental disorders, 24(5), 659-685.
Lotter, V. (1974). Factors related to outcome in autistic children. Journal of Autism and Child-hood Schizophrenia,4(3), 263-277.
Maneesriwongul, W. & Dixon, J. K. (2004). Instrument translation process: a methods review. Journal of advanced nursing, 48(2), 175-186.
Matson, J. L. & Kozlowski, A. M. (2011). The increasing prevalence of autism spectrum disor-ders. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(1), 418-425.
Mohanad N.Sabry, S. d. B. (p. d.). Traduction arabe non validée du CAST. Récupérée 25 juillet 2018, à partir de
http://docs.autismresearchcentre.com/tests/CAST_Arabic.zip
Morales-Hidalgo, P., Roige-Castellvi, J., Vigil-Colet, A. & Canals Sans, J. (2017). The Child-hood Autism Spectrum Test (CAST): Spanish adaptation and validation. Autism Re¬search, 10(9), 1491-1498.
Nordin, V. & Gillberg, C. (1998). The long-term course of autistic disorders: update on follow-up studies. Acta Psychiatrica Scandinavica, 97(2), 99-108.
Organisation des Nations Unies. (2015). « World Population Prospects: The 2015 Revision ». Récupérée 25 juillet 2018, à partir de http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm
El-Ouardi. (2014). La 2ème Rencontre Nationale sur la Santé Scolaire et Universitaire et la Promotion de la Santé des Jeunes. Récupérée 25 juillet 2018, à partir de www.sante.gov. ma/Documents/Actualites/disscours-03-2014fr.pdf
Pruette,J. R.(2013).AutismDiagnosticObservation Schedule-2(ADOS-2). Google Scholar. Risi, S., Lord, C., Gotham, K., Corsello, C., Chrysler, C., Szatmari, P., Pickles, A. (2006). Combining information from multiple sources in the diagnosis of autism spectrum disor ders. Journal of the American Academy of Child& Adolescent Psychiatry, 45(9), 1094¬1103. Robins, D. L., Fein, D., Barton, M. L. & Green, J.A. (2001). The Modified Checklist for Autism in Toddlers: an initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders. Journal of autism and developmental disorders,31(2),131-144. Rutter, M., Le Couteur, A. & Lord, C. (2003). ADI-R. Autism diagnostic interview revised. Manual. Los Angeles:WesternPsychological Services.
Rutter, M. [Michael]. (1978). Diagnosis and definition of childhood autism. Journal of autism and childhood schizophrenia, 8(2), 139-161.
Samadi, S. A., Mahmoodizadeh, A. & McConkey, R. (2012). A national study of the prevalence of autism among five-year-old children in Iran. Autism, 16(1), 5-14. Schopler, E., Reichler, R.J.&Renner, B. R.(2002). The childhood autismrating scale (CARS). Western Psychological Services Los Angeles, CA.
Scott, F. J., Baron-Cohen, S., Bolton, P. & Brayne, C. (2002). The CAST (Childhood Asperger Syndrome Test) Preliminary development of a UK screen for mainstream primary-school-age children. Autism, 6(1), 9-31.
Sousa, V. D. & Rojjanasrirat, W. (2011). Translation, adaptation and validation of instruments or scales for use in cross-cultural health care research: a clear and user friendly guideline. Journal of evaluation in clinical practice, 17(2), 268-274.
Spence, S. J., Sharifi, P. & Wiznitzer, M. (2004). Autism spectrum disorder: screening, diagnosis, and medical evaluation. In Seminarsin Pediatric Neurology(T.11,3,p.186-195). Elsevier.
Sperber, A. D. (2004). Translation and validation of study instruments for cross-cultural research. Gastroenterology, 126, S124-S128.
Squires, J., Bricker, D., Twombly, E. et al. (2002). Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional (ASQ: SE) : apparent completed, child- monitoring system for social emotional behaviors. Baltimore: Paul H. Brookes.
Stone, W. & Ousley, O. Y. (2008). Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children(STAT). VanderbiltUniversity.
Sun, X., Allison, C., Auyeung, B., Matthews, F. E., Norton, S., Baron-Cohen, S.& Brayne, C. (2014). Psychometric properties of the mandarin version of the childhood autism spec trum test (CAST) : An exploratory study. Journal of autism and developmental disorders,
44(7), 1565-1576.
van Ballegooijen, W., Riper, H., Cuijpers, P., van Oppen, P. & Smit, J. H. (2016). Validation of online psychometric instruments for common mental health disorders : a systematic review. BMC psychiatry, 16(1), 45.
Vanegas, S. B., Magafia, S., Morales, M. & McNamara, E. (2016). Clinical validity of the ADI-R in a US-based Latino population. Journal of autism and developmental disorders, 46(5), 1623-1635.
Volkmar, E, Cook, E. H., Pomeroy, J., Realmuto, G., Tanguay, P. et al. (1999). Practice parameters for the assessment and treatment of children, adolescents, and adults with autism and other pervasive developmental disorders. Journal of the AmericanAcademy of Child&Adolescent Psychiatry, 38(12), 32S-54S.
Vulchanova, M., Djalev, L., Stankova, M., Vulchanov, V., Allison, C. & Baron-Cohen, S. (2016). Factor structure of the Bulgarian CAST :(Childhood Autism Spectrum Test). Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment, 4(2), 117-128.
Wallace, K. S. & Rogers, S. J. (2010). Intervening in infancy: implications for autism spectrumdisorders. Journal ofChild Psychology and Psychiatry, 51(12), 1300- 1320. Weiner Luisa. (2007). Traduction française du CAST. Récupérée 25 juillet 2018, à partir de http://docs.autismresearchcentre.com/tests/CAST_Francais_Weiner.doc Western Psychological Services. (2018). WPS Titles in Commercial Translation. Récupérée 25 juillet 2018, à partir de https://bit.ly/2waZogZ
Williams, J., Allison, C., Scott, F., Stott, C., Bolton, P., Baron-Cohen, S. & Brayne, C. (2006). The Childhood Asperger Syndrome Test (CAST) Test—retest reliability. Autism, 10(4), 415-427.
Williams, J., Scott, E, Stott, C., Allison, C., Bolton, P., Baron-Cohen, S. & Brayne, C. (2005). The CAST (childhood asperger syndrome test) test accuracy. Autism, 9(1), 45-68. Williams, J. G., Allison, C., Scott, F. J., Bolton, P. E, Baron-Cohen, S., Matthews, E E. & Brayne, C. (2008). The childhood autism spectrum test (CAST): Sex differences. Journal of autism and developmental disorders, 38(9), 1731.
Yanos, P. T., Roe, D., Markus, K. & Lysaker, P. H. (2008). Pathways between internalized stigma and outcomes related to recovery in schizophrenia spectrum disorders. Psychiatric Services, 59(12), 1437-1442. 1414
Annexes