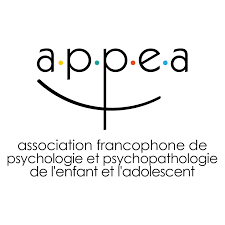Amèle El Achhab1 et René Pry2
- Doctorante à l’université Mohamed VI, Casablanca. amele.elachhab@chaaletjonas.org
- Professeur émérite de Psychologie. rene.pry@wanadoo.fr
Résumé : Si l’impact d’un trouble visuel (erreurs de réfraction) sur les apprentissages scolaires est bien documenté chez les enfants ordinaires, on manque cruellement de données chez les enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). La présente étude, et contrairement à des conceptions intuitives, laisse à entendre que cet impact, si impact il y a, ne concerne pas le traitement des informations visuelles, mais celui du langage, et plus précisément les compétences à catégoriser et à abstraire. Une hypothèse de nature développementale est alors suggérée.
Mots clés : Trouble du spectre de l’autisme, trouble des apprentissages, trouble de la vision, développement du langage.
Abstract: If the impact of a visual disorder (refractive errors) on academic learning is well documented in ordinary children, there is a severe lack of data in children with autism spectrum disorder (ASD). The present study, and contrary to intuitive conceptions, suggests that this impact, if there is any impact, does not concern the processing of visual information, but that of language, and more precisely the skills to categorize and abstract. A hypothesis of a developmental nature is then suggested.
Keywords: Autism spectrum disorder, learning disorder, vision disorder, language development.
__________________________________________________________________________________
Introduction
Les troubles de la vision (TV) les plus fréquents chez l’enfant sont des erreurs de réfraction (myopie, hypermétropie, astigmatisme), amblyopie (œil paresseux), strabisme et dyschromatopsie (altérations de la vision des couleurs) (Cavézian et al., 2010). Ils ont un impact, quand ils ne sont ni repérés ni corrigés sur le traitement des informations visuospatiales comme les activités ludiques (puzzles, encastrements…), sur le dessin, et sur les apprentissages culturels comme la lecture (Drover et al., 2008 ; Davidson & Quinn, 2011 ; Fan et al., 2011 ; Quaid et al., 2013 ; Ying et al., 2014 ; Ciner et al., 2014 ; Broadbent et al., 2014 ; Kovarski et Orssaud, 2019 ; Kulp et al., 2022 ; Phansalkar et al., 2022)
Ces troubles visuels peuvent être présents dans le trouble du spectre de l’autisme (TSA) (Simmons et al., 2009). Dans la mesure où nous ne disposons pas de données sur la prévalence de ces troubles dans le TSA, il faut se garder de toute interprétation quant à la nature de leur association. Si on trouve, par exemple, une surreprésentation de la myopie chez les enfants avec haut potentiel intellectuel, le phénomène reste sans explication à ce jour (Shevchenko et al., 2023). En conséquence, si une relation particulière entre troubles de la vision (TV) et autisme (TSA) n’est pas systématiquement à exclure, il faut se garder de tout commentaire hâtif.
En revanche, on peut se demander si la présence d’un trouble de la réfraction chez un enfant avec TSA à un impact sur son fonctionnement cognitif (Kaplan et al., 1999). En effet, l’autisme s’accompagne systématiquement d’un traitement particulier des informations visuelles (Grandin, 2009 ; Mottron et al., 2001 ; Samson et al., 2012), et dans ce cas, l’association d’avec un TV pourrait être un facteur d’aggravation, ou au contraire de protection, dans la mesure, où les activités précédemment citées peuvent être surinvestis, et parfois, se traduire par des hypercompétences. D’autre part, le développement du langage dans le TSA est très particulier (Schaeffer et al., 2023), et il est souvent précédé d’un attrait pour les lettres et les alphabets (Ostrolenk et al., 2024), qui peut quelquefois se traduire par une « hyperlexie » où l’enfant est capable de déchiffrer un texte avant de parler (Ostrolenk et al., 2017). Kissine (Kissine et al., 2019) cite le cas d’un enfant tunisien qui a appris seul une forme d’arabe (la forme « télévisuelle »), non parlée par les parents ou l’entourage, à partir du prélèvement des informations sur les tablettes. Il paraît donc légitime de s’interroger si un trouble de la vision peut aussi impacter le développement de l’activité linguistique
Traitement visuel et autisme.
La dernière classification des troubles mentaux (DSM-5) (APA, 2013) a réintroduit dans ses critères diagnostiques la notion de « particularités sensorielles ». Ces particularités se manifestent soit sous la forme d’une hyperréactivité, soit d’une hyporéactivité. Elles sont présentes dans le traitement réceptif des informations, dans ce cas elles ne sont pas spécifiques au TSA, mais elles se manifestent surtout dans la production de comportements qui témoignent alors d’une activité propre, voire typique au TSA (Turner, 1999).
Dans ce cadre ce sont des comportements qui entrent dans le critère diagnostique des « Comportements répétitifs et intérêts restreints » (CRIR). Ils vont se développer avec l’avancée en âge, et leurs degrés de complexité sont corrélés positivement au niveau intellectuel (Courchesne et al., 2021 ; Uljarevic at al., 2022). Ces comportements se définissent par la nécessité de leur activation et par le fait qu’ils sont associés à des émotions positives. Ils sont inhabituels et leurs intérêts ne concernent qu’une partie d’un ensemble plus important.
Dans le traitement visuel, chez l’enfant jeune, et en réception, cela va se traduire par un attrait intense pour les lettres, les chiffres et les moyens de transport. Certaines personnes peuvent aussi être extrêmement sensibles à la lumière, aux couleurs vives ou aux mouvements rapides. Cela peut alors provoquer une surcharge sensorielle, conduisant à une anxiété accrue ou des comportements d’évitement.
En production, cela se traduit par des activités de recherche d’information, nommées « Comportements d’Exploration Visuelle Atypique » (CEVA). Ils comprennent le regard latéral d’un objet, l’observation de près, l’observation du reflet dans un miroir, le regard obstrué, l’observation d’un objet en mouvement ou encore l’observation d’un axe horizontal ou vertical. D’autres peuvent ne pas réagir autant aux stimuli visuels et peuvent rechercher une stimulation supplémentaire en fixant des objets scintillants ou en portant une attention excessive à des détails.
Avec l’avancée en âge, enfance et adolescence, et la spécialisation des compétences, ces CRIR vont augmenter et se complexifier avec le développement. Ils vont se porter sur des parties d’objets ou des catégories spécifiques (vitres arrière des voitures, mots de 4 lettres, plantes carnivores, pierres précieuses, feux de circulation…), sur la lecture), le graphisme, et c’est ainsi qu’à l’âge adulte, on peut rencontrer des personnes qui parlent plusieurs dizaines de langues rares, des dessinateurs exceptionnels, des calendriers savants… Si, enfin, certains CRIR peuvent avoir, comme dans le développement habituel, une fonction adaptative (rituels, résistance au changement) dans la mesure où on observe des pics dans leurs évolutions, de manière générale la fréquence de ces comportements de « bas niveau » a tendance à baisser chez l’adulte.
Méthodologie
60 enfants ont participé à l’étude. Ces enfants ont consulté dans un centre spécialisé dans les troubles neurodéveloppementaux au Maroc. 30 ont reçu le diagnostic de Trouble du Spectre de l’autisme (TSA) et 30 celui de Trouble des apprentissages (TA), que ces apprentissages portaient sur l’écrit ou sur la numération. Parmi les 28 enfants avec TSA, G1 : 15 présentent un trouble visuel (TSA-TV) et G2 : 15 n’en présentaient pas (TSA-nTV) ; parmi les 30 présentant un Trouble du développement du langage, G3 : 15 présentent un trouble visuel (TDL-TV) et G4 : 15 n’en présentaient pas (TDL-nTV).
On notera que le TSA et la TA peuvent associés à d’autres TND comme le Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) ou à un Trouble du développement du langage (TDL). Ces associations sont bien entendu présentes chez certains enfants de l’échantillon.
Le diagnostic de TSA a été fait par un neuropsychiatre à partir des 5 critères du DSM-5, remplis par les scores à deux échelles : l’ADI-R (Lord et al., 1994) et l’ADOS module 2 ou 3 (Gotham et al., 2007 ; Gray et al., 2008 ; Frigaux et al., 2019 ; Hong et al., 2021). Le diagnostic de TA était proposé à la suite des difficultés scolaires rencontrées par ces enfants dans les apprentissages culturels (lecture et/ou numération) et la positivité des critères du DSM-5.
Les 4 sous-groupes ont été appariés sur l’âge chronologique, sur le sexe (par groupe de diagnostic), et sur une mesure de leur intelligence fluide.
Cet appariement se justifie pour les raisons suivantes. L’âge chronologique est un marqueur des trajectoires développementales. Dans le TSA, entre 12 et 60 mois, le développement de l’activité linguistique est le plus souvent problématique, et l’estimation du niveau intellectuel verbal (QIV) n’a alors guère de sens. En revanche, l’intelligence non verbale et plus précisément l’intelligence « fluide » (Schneider et al., 2012), celle qui permet de s’adapter au quotidien, est plus rarement touchée. De plus le niveau de ce type d’intelligence permet d’écarter ou non la présence d’un trouble du développement intellectuel. Quant au sex-ratio, il est déséquilibré dans tous les TND où l’on observe une surreprésentation des garçons, probablement pour des raisons épigénétiques, la présence d’un seul chromosome X chez ces derniers augmentant les mutations exprimées.
Aux 60 enfants de l’échantillon ont été administrés deux épreuves, le WISC-V et le DTVP-2. Ces deux épreuves ont été étalonnées sur des échantillons représentatifs de la population française. Ce sont des échelles multifactorielles dont les scores standard se distribuent autour d’une moyenne de 10 et d’écart-type 3. Au regard de l’hétérogénéité des profils moyens chez ces enfants, le calcul d’un score global, même s’il peut être calculé, pose des problèmes d’interprétation et de comparaisons statistiques entre les groupes (Nader et al., 2016). Il a donc été décidé de ne conserver que certains subtests de ces deux épreuves.
Le « Developmental Test of Visual Perception », Second Edition (DTVP-2) est un outil d’évaluation utilisé pour mesurer les capacités de perception visuelle et les habiletés visuomotrices chez les enfants âgés de 4 à 10 ans. L’épreuve permet d’identifier les problèmes de perception visuelle qui peuvent affecter les performances scolaires et les activités de la vie quotidienne. Deux subtests, sur les six de l’épreuve ont été retenus : « Figure-Ground (Figure-fond) » qui évalue la capacité de l’enfant à discerner une forme ou une figure spécifique dans un fond complexe et « Form Constancy (Invariance des formes) » qui évalue la capacité de l’enfant à reconnaître une forme visuelle même lorsqu’elle est présentée dans une taille, une orientation ou une couleur différente. Les tâches motrices n’ont pas été conservées au regard de la dispersion trop importante des scores dans les différents groupes.
L’Échelle d’intelligence de Wechsler pour enfants – Cinquième édition (WISC-V) est un outil psychométrique qui permet d’évaluer les capacités intellectuelles des enfants et des adolescents âgés de 6 à 16 ans. Il propose une évaluation globale ainsi qu’une analyse détaillée des différentes compétences cognitives. Parmi celles-ci ont été retenus le « Raisonnement fluide » qui estime la capacité de l’enfant à résoudre des problèmes nouveaux sans instruction préalable. Ce type de raisonnement est mobilisé dans deux subtests : « Matrices » ou l’enfant doit identifier le morceau manquant d’un motif, et « Balances » ou l’enfant doit résoudre des problèmes impliquant des relations quantitatives.
De plus, pour juger des capacités verbales et d’abstraction de l’enfant, notamment la compréhension et l’expression, c’est le subtest « Similitudes » qui a été choisi, subtest dans lequel l’enfant doit expliquer en quoi deux objets ou deux concepts verbaux sont similaires.
Le traitement des données a été effectué avec des analyses de variance (ANOVA) et le test de Fisher LSD (Least Significant Difference). Ce test post-hoc permet d’identifier quelles paires de moyennes de groupes sont significativement différentes les unes des autres après qu’une ANOVA ait révélé des différences globales significatives.
Résultats
Les variables qui sont contrôlées sont l’âge chronologique, le sexe et le niveau de « l’intelligence fluide ». Il n’a pas possible de maîtriser si les difficultés visuelles étaient corrigées, ou non. Certains enfants, 60 %, ne portaient pas de correction et parmi les 40 % appareillés, il y a de fortes présomptions pour que les corrections portées par la moitié d’entre eux ne soient pas adaptées aux conditions de la scolarité. Quoiqu’il en soit, tous les enfants disposaient d’une acuité supérieure à 41/10.
Les données sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 1. Caractéristiques d’appariement des 4 groupes
| G1 | G2 | G3 | G4 | P value | |
| Effectif | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Age (mois) | 127 (19) | 115 (19) | 103 (19) | 124 (21) | 0,26 |
| Garçons | 11 | 10 | 9 | 10 | 0,19 |
| Filles | 3 | 4 | 5 | 4 | 0,23 |
| Matrices | 9,08 (3,70) | 9,27 (2,37) | 11,54 (3,75) | 11,60 (3,14) | 0,16 |
| Balances | 8,07 (2,46) | 10,36 (1,85) | 10,45 (3,23) | 10,80 (3,63) | 0,12 |
Dans le tableau 2 sont décrits les scores standard (moyenne et écart- type) obtenus par les enfants des quatre groupes dans les deux subtests du DTVp-2, et dans le subtests « similitudes » du WISC-V.
Tableau 2 : moyenne et écart-type des notes standard.
| Figure-Fond | Constance Formes | Similitudes | |
| G1 | 9,52 (2,34)) | 10,00 (3,41) | 8,08 (3,90) |
| G2 | 8,36 (2,12) | 9,45 (3,01) | 11,54 (3,58) |
| G3 | 8,54 (2,95) | 8,72 (2,41) | 11,45 (3,83) |
| G4 | 7,38 (2,50) | 8,80 (3,42) | 11,00 (3,54) |
Enfin, dans le tableau 3 sont présentées les p-values obtenues en calculant les différences 2 à 2 entre les groupes sur le scores des 3 tâches précédentes.
Tableau 3 : p-values de comparaison entre les 4 groupes pris 2 à 2/
| Figure-Fond | Constance Formes | Similitudes | |
| G1 vs G2 | 0,68 | 0,27 | 0,02 |
| G1 vs G3 | 0,34 | 0,19 | 0,03 |
| G1 vs G4 | 0,48 | 0,02 | 0,13 |
| G2 vs G3 | 0,59 | 0,84 | 0,95 |
| G2 vs G4 | 0,70 | 0,16 | 0,78 |
| G3 vs G4 | 0,96 | 0,21 | 0,82 |
Discussion
Trois scores semblent ne pas pouvoir être imputés au seul hasard : celui qui compare les performances dans l’épreuve « Invariance des formes » qui concerne les groupes (TSA-DV » et « TA-nDV », et ceux qui comparent les résultats de « Similitude » entre les groupes « TSA-DV et TSA-nDV » et « TSA-DV et TA-DV ».
La meilleure réussite des enfants TSA dans ce type de tâche est une donnée bien documentée dans la littérature. Ce constat a été théorisé par L. Mottron (Mottron, 1999) sous le concept de « surfonctionnement perceptif ». Cette supériorité est confortée par la supériorité relative retrouvée dans l’épreuve « Figure-Fond » (Cribb et al., 2016). En revanche, il semblerait que la présence d’un trouble visuel chez les enfants de 9-10 ans ne les pénalise pas, ce qui est aussi le cas pour les enfants montrant des difficultés d’apprentissage. En conséquence, et contrairement à des attentes naturelles, les troubles visuels n’impactent pas les enfants avec TSA dans des tâches qui mobilisent leur organisation perceptive et leur peu de sensibilité aux biais perceptifs présents dans le développement ordinaire.
Concernant le subtest « Similitudes », la réussite est incontestablement moindre chez les enfants avec TSA et Troubles visuels (G1). Cette tâche mobilise l’activité linguistique dans sa compétence à former des concepts, et dont la difficulté croissante des items fait appel aux possibilités d’abstraction, ces dernières augmentant dans le temps et avec l’âge.
Pour le DSM-5 et dans le TSA, le langage expressif est considéré comme étant un spécificateur, c’est-à-dire que le niveau de l’activité linguistique n’est pas dépendant des caractéristiques cliniques du trouble, et la variation des niveaux de langage observée est extrême : de l’absence totale de langage en production à la présence d’un langage ampoulé, pédant, hypergrammatical et précis. Et pourtant, dans une position développementale, il est difficile d’ignorer que dans la plupart des TSA, le développement du langage se superpose avec celui des premiers développements du trouble et en est même une caractéristique centrale.
Sa trajectoire s’effectue en baïonnette (Gagnon, 2021). À la suite d’une période où les premiers mots sont acquis (ou n’apparaissent pas), le langage régresse brutalement et laisse place à un plateau sans langage communicatif dirigé vers le partenaire (cela se traduit par exemple par une absence de réponse à son prénom). Lorsque le plateau s’achève, le langage (ré)apparaît de façon particulière avec des écholalies associées à la question, des stéréotypies et des inversions pronominales, et le meilleur prédicteur actuel du niveau de langage qui sera atteint reste le niveau intellectuel (Wodka et al., 2013).
La particularité du développement linguistique dans le TSA est qu’il se met en place sans prendre en compte le partenaire, juste en se mobilisant sur des informations écrites ou orales (livres, tablettes…) c’est-à-dire issues d’un cadre non interactif.
L’enfant autiste va alors se mettre à parler de façon autodidacte, sans qu’il y ait nécessité de la présence d’un congénère, en repérant les régularités de ces matériels visuels, en les organisant, les emboîtant, et très probablement en mobilisant les mêmes mécanismes que ceux qui sont nécessaires au langage : syntaxe minimaliste et grammaire universelle (Chomsky, 2014), mais en les appliquant à des informations structurées, régulières, séquentielles et non communicatives (lettres, chiffres, phrases mémorisées entendues à la télévision…) (Abidova, 2013). Dans le TSA l’apprentissage d’une langue ne semble pas se faire par exposition ou par immersion dans un « bain de langage ». Tout se passait comme si dans l’autisme, la communication était dissociée entre ses aspects formels et sa composante pragmatique : « ça parle, mais ça ne parle à quelqu’un ».
L’échec relatif à « Similitudes » dans le G1, et le maintien des performances dans le G2, pourrait être assez bien expliqué par cette période de plateau, dont les enfants avec TSA sortent entre 5 et 6 ans, et durant laquelle ils se consacrent à une exploration active de matériaux non verbaux. Cette exploration va les préparer à aborder le langage oral plus tard, et elle pourrait être perturbée par leurs difficultés visuelles, dans la mesure où l’adaptation à ces dernières n’est pas encore effective.
Enfin, la « bonne réussite » des enfants du G2 dans ce subtest n’est en rien surprenante dans la mesure où cette compétence à catégoriser et à abstraire est indépendante des caractéristiques du contexte de recueil et d’énonciation et ne fait pas appel à des compétences pragmatiques.
Conclusion
La question de l’impact d’un trouble visuel (difficulté de réfraction) chez les enfants de 9-10 ans présentant également un trouble du spectre de l’autisme mérite d’être posée. C’est en effet à cet âge que la clinique du TSA est stabilisée et que les apprentissages scolaires et culturels sont intenses. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’impact, si impact il y a, ne porte pas sur les activités qui mobilisent la perception visuelle, mais sur l’activité linguistique. L’hypothèse qui est suggérée est la suivante. La plupart de ces enfants sortent d’une phase de plateau (absence de langage en production durant une période qui peut varier de quelques mois à quelques années), période durant laquelle ils se sont mobilisés activement sur des tâches de nature non verbale. Si par ailleurs, on pense que le langage est traité de la même façon que sont traités les informations visuelles, c’est-à-dire en court-circuitant le rapport au partenaire et en mobilisant des mécanismes identiques, les répercussions des troubles visuels sur le développement de la catégorisation et de l’abstraction verbale chez les enfants TSA de 9-10 ans ne seraient alors que les stigmates de ce palier caractérisé par une absence de langage parlé.
References
Abidova, N. Z. (2013). Peculiarities of the Formation and Development of Vocabulary in Children with Vision Disorders. European Researcher, 2‑3, 475‑479.
American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). Washington D.C: American Psychiatric Publishing, 2013.
Broadbent, P. A. (2014). Visual Efficiency and the Relationship Between Reading and Behaviors Indicating Difficulties in the Classroom in Elementary School-Age Children. Retrieved from http://digitalcommons.pcom.edu/psychology_dissertations
Cavézian, C., Vilayphonh, M., de Agostini, M., Vasseur, V., Watier, L., Kazandjian, S., … Chokron, S. (2010). Assessment of visuo-attentional abilities in young children with or without visual disorder: Toward a systematic screening in the general population. Research in Developmental Disabilities, 31(5), 1102–1108. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2010.03.006
Chomsky, N. (2014). Aspects of the Theory of Syntax, 50th Anniversary Edition. MIT Press.
Ciner, E. B., Ying, G., Kulp, M. T., Maguire, M. G., Quinn, G. E., Orel-Bixler, D., Cyert, L. A., Moore, B., Huang, J., & Group, V. in P. (VIP) S. (2014). Stereoacuity of preschool children with and without vision disorders. Optometry and vision science, 91(3), 351‑358.
Courchesne, V., Bedford, R., Pickles, A., Duku, E., Kerns, C., Mirenda, P., Bennett, T., Georgiades, S., Smith, I. M., Ungar, W. J., Vaillancourt, T., Zaidman-Zait, A., Zwaigenbaum, L., Szatmari, P., Elsabbagh, M., & Pathways Team. (2021). Non-verbal IQ and change in restricted and repetitive behavior throughout childhood in autism: A longitudinal study using the Autism Diagnostic Interview-Revised. Molecular Autism, 12(1), 57.
Cribb, S. J., Olaithe, M., Di Lorenzo, R., Dunlop, P. D., & Maybery, M. T. (2016). Embedded Figures Test Performance in the Broader Autism Phenotype: A Meta-analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(9), 2924–2939. https://doi.org/10.1007/s10803- 016-2832-3
Davidson, S., & Quinn, G. E. (2011). The impact of pediatric vision disorders in adulthood. Pediatrics, 127(2), 334‑339.
Drover, J. R., Kean, P. G., Courage, M. L., & Adams, R. J. (2008). Prevalence of amblyopia and other vision disorders in young Newfoundland and Labrador children. Canadian Journal of Ophthalmology, 43(1), 89‑94.
Fan, D. S., Lai, C., Lau, H. H., Cheung, E. Y., & Lam, D. S. (2011). Change in vision disorders among Hong Kong preschoolers in 10 years. Clinical & Experimental Ophthalmology, 39(5), 398‑403. https://doi.org/10.1111/j.1442-9071.2010.02470.x
Frigaux, A., Evrard, R., & Lighezzolo-Alnot, J. (2019). [ADI-R and ADOS and the differential diagnosis of autism spectrum disorders: Interests, limits and openings]. L’Encephale, 45(5), 441‑448. https://doi.org/10.1016/j.encep.2019.07.002
Gagnon, D., Zeribi, A., Douard, É., Courchesne, V., Rodríguez-Herreros, B., Huguet, G., Jacquemont, S., Loum, M. A., & Mottron, L. (2021). Bayonet-shaped language development in autism with regression: A retrospective study. Molecular Autism, 12(1), 35. https://doi.org/10.1186/s13229-021-00444-8
Gotham, K., Risi, S., Pickles, A., & Lord, C. (2007). The Autism Diagnostic Observation Schedule: Revised algorithms for improved diagnostic validity. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(4), 613‑627. https://doi.org/10.1007/s10803-006-0280-1
Grandin, T. (2009). Visual Abilities and Sensory Differences in a Person with Autism. Biological Psychiatry, 65(1), 15–16. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2008.11.005
Gray, K. M., Tonge, B. J., & Sweeney, D. J. (2008). Using the Autism Diagnostic Interview-Revised and the Autism Diagnostic Observation Schedule with young children with developmental delay: Evaluating diagnostic validity. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(4), 657‑667. https://doi.org/10.1007/s10803-007-0432-y
Hong, J. S., Singh, V., Kalb, L., Ashkar, A., & Landa, R. (2021). Replication study of ADOS-2 Toddler Module cut-off scores for autism spectrum disorder classification. Autism Research: Official Journal of the International Society for Autism Research, 14(6), 1284‑1295. https://doi.org/10.1002/aur.2496
Kaplan, M., Rimland, B., & Edelson, S. M. (1999). Strabismus in autism spectrum disorder. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 14(2), 101–105.https://doi.org/10.1177/108835769901400205
Kissine, M., Luffin, X., Aiad, F., Bourourou, R., Deliens, G., & Gaddour, N. (2019). No colloquial Arabic in Tunisian Children with Autism Spectrum Disorder: A Possible Instance of Language Acquisition in a Noninteractive Context. Language Learning, 69(1), 44‑70. https://doi.org/10.1111/lang.12312
Kovarski, & Orssaud. (2019). Impact des troubles visuels sur l’apprentissage scolaire. Approche Neuropsychologique Des Apprentissages Chez l’Enfant, 195.
Kulp, M. T., Ciner, E., Ying, G., Candy, T. R., Moore, B. D., & Orel-Bixler, D. (2022a). Vision Screening, Vision Disorders, and Impacts of Hyperopia in Young Children: Outcomes of the Vision in Preschoolers (VIP) and Vision in Preschoolers – Hyperopia in Preschoolers (VIP-HIP) Studies. The Asia-Pacific Journal of Ophthalmology, 11(1), 52-58. https://doi.org/10.1097/APO.0000000000000483
Lord C, Rutter M, Le Couteur A. Autism Diagnostic Interview- Revised: a revised version of a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developmental disorders. J Autism Dev Disord 1994; 24:659–85. http://dx.doi.org/10.1007/BF02172145
Mottron, L, Burack, J. a. J., Dawson, M., Soulières, I., & Hubert, B. (2001). Enhanced perceptual functioning in the development of autism. The Development of Autism: Perspectives from Theory and Research. https://doi.org/10.1007/s10803-005-0040-7
Mottron, L., Burack, J. A., Stauder, J. E. A., & Robaey, P. (1999). Perceptual Processing among High-functioning Persons with Autism. The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 40(2), 203‑211. https://doi.org/10.1111/1469-7610.00433
Nader, A. M., Courchesne, V., Dawson, M., & Soulières, I. (2016). Does WISC-IV Underestimate the Intelligence of Autistic Children? Journal of Autism and Developmental Disorders. https://doi.org/10.1007/s10803-014-2270-z
Ostrolenk, A., Forgeot d’Arc, B., Jelenic, P., Samson, F., & Mottron, L. (2017). Hyperlexia: Systematic review, neurocognitive modelling, and outcome. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 79, 134‑149. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.04.029
Ostrolenk, A., Gagnon, D., Boisvert, M., Lemire, O., Dick, S.-C., Côté, M.-P., & Mottron, L. (2024). Enhanced interest in letters and numbers in autistic children. Molecular Autism, 15(1), 26. https://doi.org/10.1186/s13229-024-00606-4
Phansalkar, R., Lockman, A. J., Bansal, S., & Moss, H. E. (2022). Management of Functional Vision Disorders. Current Neurology and Neuroscience Reports, 22(4), 265‑273. https://doi.org/10.1007/s11910-022-01191-w
Quaid, P., & Simpson, T. (2013). Association between reading speed, cycloplegic refractive error, and oculomotor function in reading disabled children versus controls. Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 251(1), 169–187. https://doi.org/10.1007/s00417-012-2135-0
Samson, F., Mottron, L., Soulières, I., & Zeffiro, T. A. (2012). Enhanced visual functioning in autism: An ALE meta-analysis. Human Brain Mapping, 33(7), 1553–1581. https://doi.org/10.1002/hbm.21307
Schaeffer, J., Abd El-Raziq, M., Castroviejo, E., Durrleman, S., Ferré, S., Grama, I., Hendriks, P., Kissine, M., Manenti, M., Marinis, T., Meir, N., Novogrodsky, R., Perovic, A., Panzeri, F., Silleresi, S., Sukenik, N., Vicente, A., Zebib, R., Prévost, P., & Tuller, L. (2023). Language in autism: Domains, profiles and co-occurring conditions. Journal of Neural Transmission, 130(3), 433‑457. https://doi.org/10.1007/s00702-023-02592-y
Schneider, W. J., & McGrew, K. S. (2012). The Cattell-Horn-Carroll model of intelligence. In D. Flanagan & P. Harrison (Eds.), Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues (3 rd ed., p. 99–144). New York: Guilford.
Shevchenko, V., Labouret, G., Guez, A., Côté, S., Heude, B., Peyre, H., & Ramus, F. (2023). Relations between intelligence index score discrepancies and psychopathology symptoms in the EDEN mother-childbirth cohort. Intelligence, 98, 101 753.
Simmons, D. R., Robertson, A. E., McKay, L. S., Toal, E., McAleer, P., & Pollick, F. E. (2009). Vision in autism spectrum disorders. Vision Research, 49(22), 2705–2739. https://doi.org/10.1016/j.visres.2009.08.005
Turner M. Annotation: Repetitive behavior in autism: A review of psychological research. J Child Psychol Psychiatry. 1999; 40:839–849. DOI: 10,111 1/1469-7610.00502
Uljarević, M., Frazier, T. W., Jo, B., Billingham, W. D., Cooper, M. N., Youngstrom, E. A., Scahill, L., & Hardan, A. Y. (2022). Big Data Approach to Characterize Restricted and Repetitive Behaviors in Autism. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 61(3), 446-457. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2021.08.006
Wodka, E. L., Mathy, P., & Kalb, L. (2013). Predictors of Phrase and Fluent Speech in Children With Autism and Severe Language Delay. Pediatrics, 131(4), e1128‑e1134. https://doi.org/10.1542/peds.2012-2221
Ying, G., Maguire, M. G., Cyert, L. A., Ciner, E., Quinn, G. E., Kulp, M. T., Orel-Bixler, D., Moore, B., & Group, V. in P. (VIP) S. (2014). Prevalence of vision disorders by racial and ethnic group among children participating in head start. Ophthalmology, 121(3), 630‑636.